|
Elle s’intéresse au contenu du document ,on l’appelle aussi :<<critique du témoins >> ou encore <<critique de crédibilité>>
En effet au cours de cette critique de crédibilité, l’historien cherche a juger la crédibilité du témoins en mesurant le degré de confiance que mérite l’auteur c’est-à-dire établir la valeur du témoin et du témoignage. Cette critique tourne autour de deux examens : - critique d’interprétation ou herméneutique ou exégèse et - la critique d’autorité 1. Critique d’interprétation ou herméneutique ou exégèse Elle vise à établir le sens du document c’est- à -dire à préciser ce que l’auteur dit et ce qu’il a voulu dire. Il s’agit de bien comprendre ou de bien interpréter le document et de bien savoir ce que l’auteur a dit. Ainsi on s’arrache à la signification de chaque mot, chaque phrase et du paragraphe entier. 2. Critique d’autorité Elle va établir la crédibilité, la confiance que l’auteur mérite. Elle essaie de voir si les faits perçus par le témoin n’ont pas été modifié. Pour cela l’historien se base sur trois autres critiques :
Elle va établir la valeur de l’observation du témoin. (Basée sur les sens) - l’auteur a-t-il bien observé ? - A-t-il été capable de bien observer c.-à-d. de bien percevoir et de bien comprendre ? - Ses sens sont –ils normaux? (myopie, daltonisme, fatigue, éloignement, préoccupation, etc.) - Disposait-il d’une capacité intellectuelle et des qualités voulues pour observer et comprendre le sens de l’événement qu’il décrit ou rapporte. Est –il exempt des préjugés ? & . Critique de sincérité On tache de connaître les déformations volontaires dues à plusieurs causes. - L’auteur a-t-il noté correctement son observation ? -N’a-t-il pas commis certaines erreurs involontaires dues à l’infidélité de la mémoire, à la faiblesse intellectuelle. -Est -il précis? -Se soucie –t-il du détail? & .critique du témoignage Elle détermine si les faits rapportés sont historiquement; certains, probables, inadmissibles, on y arrive par :
a)par confrontation du témoin A condition que le témoin soit strictement indépendant. S’ils sont d’accord il y a certitude, s’il ya désaccord, on s’en tient au document plus confiant. b)par argument a priori : C’est-à-dire nier un fait attesté par le témoin parce qu’il va a l’encontre de la loi. - La loi physique : lois qui régissent la nature et la physiologie. -morales : les lois qui régissent l’activité libre et consciente. -métaphysique. 3 .critique d’exactitude On tache de connaître la déformation inconsciente dus à plusieurs causes. - L’auteur a-t-il note correctement son observation ? - N’a-t-il pas commis certaines erreurs dus à l’infidélité de la mémoire, la faiblesse intellectuelle? - Est –il permis?
2 Commentaires
Définition
- La critique historique est l’ensemble des règles à suivre pour effectuer une analyse scientifique des ressources historiques. - c’est une science qui a pour objet propre d’étudier la méthode que l’on applique pour connaitre le passé. -c’est un examen de la valeur et de la signification des sources historiques fait avec précaution avant de les utilisés. La critique historique Une fois rassemblés, les documents doivent être analysés et contrôlés. Il s’agit de s’assurer de la validité Pourquoi nous étudions la critique historique ? La documentation à laquelle l’historien fait recours pour se construire les faits humains passés sont indirects. Car l’historien n’est pas toujours témoins des faits qu’il rapporte. Avec les documents historiques, il est parfois difficile de vérifier l’authenticité car parfois le document est incomplet. Pour que la vérité historique du document soit dégagée, l’historien fait recourt à la critique historique pour rétablir la vérité première et comprendre la raison première des événements. Dans la vie courante ou professionnelle, la critique historique nous aide à développer l’esprit critique c’est - à - dire être capable de faire un jugement des faits que l’on nous raconte. 2. Les étapes de la recherche A. L’HEURISTIQUE Elle recherche a réunir toutes la documentation qui traite sur un sujet. C’est une étape important à la recherche. - les vestiges archéologiques sont découverts aux fouilles. - les traditions orales se récoltent auprès des griots et des vieillards. - Les documents écrits dans la bibliothèque. B .LA CRITIQUE HISTORIQUE Une fois rassemblés, les documents doivent êtres analyser et contrôler. Il s’agit de s’assurer de la validité et de l’authenticité des documents, c’est le rôle de la critique historiques . C .SYNTHÈSE HISTORIQUE Par la synthèse l’historien établit un récit suivant les événements. - il regroupe les faits - les interprètes - les explique et les exposes OPÉRATION DE LA CRITIQUE HISTORIQUE La critique externe Elle s’occupe de tout ce qui concerne la forme extérieur du document Elle établit depuis le début la valeur des documents. Si c’est un faux document, il ne sera plus nécessaire d’aller plus loin c’est- à -dire d’appliquer la critique interne. On se pose alors les questions : -le document est –il original ? -le document est –il une copie ou une copie d’une copie ? Elle étudie donc les textes indépendamment de leur contenu, vise à établir l’identité des documents. La critique externe à son tour se subdivise en : - Critique d’authenticité - Critique de provenance - Critique de restitution ou textuelle ou Ecdotique - Critique d’origine A .CRITIQUE D’AUTHENTICITE Elle examine si le document est vrai, original, une copie ou un faux. Elle cherche à vérifier si les indicateurs du document sont conformes à la vérité pour savoir s’il n’y a pas d’erreur en ce sujet. - un document est original quand le texte est celui que le présumé auteur avait effectivement écrit. -le document est une copie quand elle est conforme à l’original. -le document est un faux quand le contenu, la date, le lieu ou l’auteur est faux. B.LA CRITIQUE DE PROVENANCE Elle consiste a établir toute l’identité du document tout ce qui concerne son origine , son auteur , l’époque de sa rédaction, l’endroit ou le milieu ou il a été conçu, les conditions dans lesquelles il a été rédigé, la manière dont il a été transmis jusqu'à nous. En un mot, la critique de provenance est l’histoire d’un document. * L'AUTEUR Généralement le nom de l’auteur figure au début ou à la fin du document. Le document peut être anonyme (sans nom d’auteur) ou un pseudonyme (signer sous un nom emprunté) le document peut être signé par un faussaire. C . CRITIQUE DE RESTITUTION OU TEXTUELLE OU ECDOTIQUE On procède à cette critique lorsqu’on a plus d’originale ou lorsque l’original n’est plus complet. On essais alors de restituer le texte du document dans la forme originale. L’émendation : est un procédé de corriger une copie. Pour un document historique la différence entre l’original et la copie est liée à 3 types des fautes : - la faute accidentelle: elle se produit à l’insu du copiste soit par manque d’attention, fatigue, précipitation. Ces sont des mots mis et fautes d’orthographe. - la faute volontaire : le copiste modifie le texte du document intentionnellement. Il peut soit ajouter ou supprimer un passage. il est donc conscient qu’il déforme la pensée de l’auteur. - la faute de jugement : elle se fait consciemment mais sans intension de fraude. Il arrive souvent lorsque le copiste ne comprend pas le texte. Il le juge obscurément et le rend un peu claire, il le modifie , le corrige pour le rendre intelligible Situé entre le Lac Tanganyika et la rivière Kasaï de la république démocratique du Congo, le royaume Luba est l’un des royaumes remarquable du centre de l’Afrique. Leur origine vient de la migration d’un clan de l’ethnie Songhoy au XVIème siècle. Ils vivaient dans les provinces du Kasaï et de l’actuel Nord du Katanga. C’est un peuple organisé essentiellement en chefferies indépendante, des genres de tribus. Parmi ces tribus, nous trouvons Les Bena Lulua, Bena Mualaba, les Bakwanga, Bena Mutombo, Bena Mpuka, Bena Tshibanda. Chaque chefferie est sous la direction d’un Bulopwe, toute fois l’ensemble de l’empire est sous la direction du Kalamba, qui est une direction symbolique. Le premier empereur de Baluba fut Kongolo qui est aussi considéré comme l’ancêtre des Basonges selon la tradition. Leur système politique est bien plus élaborer qu’il contient des seigneuries pour regrouper un grand nombre des villages. C’est comme un détachement du système de l’empire grec de gouverneur, mais cette fois au centre de l’Afrique. Une autre ressemblance frappante est que Les balubas, comme le grec, ont aussi confiance à un oracle, le Lubuko. C’est une sorte de maison avec une porte d’entrée à l’arrière et un mûr en bois en avant. La personne à l’intérieur répondait aux questions posée par oui ou par non. Les questions étaient posées par l’interlocuteur devant le mûr de bois. Les fouilles archéologiques ont révèle que les peuples Luba utilisaient depuis le IXème siècle un monnaie en cuivre cruciforme. C’est suite à leur force économique et démographique, que les balubas parviennent à rendre leur langue une lange interethnique.
L’empire Luba fut conquis au XIXème siècle avec l’apparussions des premiers fusils dans la région. Pendant que les royaumes des côtes de l’Afrique connaissent la décadence durant le XVème siècle suite à leurs contacts avec les européens. Les royaumes du Centre sont en quelques sortes épargnés de ces vagues de dépopulation forcées par la traite de noir et l’esclavage. Toute fois, nous tenons à préciser que la plus parts des royaumes du Congo existent aujourd’hui comme chefferie et unité administratif. Certains des royaumes épargnés sont l’objet de cette leçon.
Dans le Kasaï occidentale et la Luluwa, le royaume Kuba se forme durant le XVe siècle. Il prend son essor sous le règne de Chamba Bolongongo vers le XVIIème siècle. Durant son règne, Chamba encourage les nouvelles cultures en introduisant les cultures du Maïs et de Tabac. Durant la même période, le royaume voit l’introduction du tissage du raphia, la sculpture et l’organisation d’un service militaire véritable. C’est important de noter que c’est uniquement dans le royaume Kuba, parmi les royaumes du centre de l’Afrique, où les souverains avaient institué une charge de gardien des traditions orales : Le Moaridi. A la fin du XVIIème siècle, les Luba envahirent une partie du royaume Kuba. Toute fois, celui-ci perdura jusqu'à sa soumission par les forces belges en 1904. William Shephard, missionnaire américain, visita le royaume avant sa destruction par le belge. Il dit ceci de son entrée dans les terres du royaume : « … (Le Kuba) donne l’impression d’une entrée dans un monde civilisé… peut-être qu’ils ont reçu leurs civilisations des Egyptiens – ou les Egyptiens ont reçu les leurs de Bakuba. » Shephard fut le premier étranger à visiter la ville d’Ifuca, à la court du roi Kot aMbweeky II en 1892. Nous connaissons l’époque précoloniale suite à son interaction avec les blancs. C’est toute fois une période qui vient après les vagues des migrations bantous venant des régions occidentale dont les Nigeria et le lac Tchad. Ils arrivent au Congo qui, à cette époque, est habité surtout par le peuple pygmées.
Les bantous s’installent principalement sur les côtes et les plateaux du sud et de l’Est de la RDC en évitant la forêt dense qui occupe le centre du pays. Les bantous mirent en place des empires parmi lesquels Kongo, Kuba, et Lunda. Les bantous utilisaient les tamtams comme moyen des communications. Ils ont aussi construits des forteresses et se sont faits des vêtements de textile tiré de la feuille de Bambou. Les peuples bantous possédaient des connaissances en Médecine, ils avaient des vaccins (Kutema Lulindi). L’Empire Kongo C’est l’un de plus vastes empire des Bantous au Centre de l’Afrique. Il comprenait l’Ouest de la République Démocratique du Congo, Le Congo-Brazzaville et l’Angola lors de son apogée. Les relations entre les Bakongos et le Batéké, au Nord, sont surtout commerciale mais parfois hostiles. L’économie de l’empire se fonde sur l’agriculture surtout la production des ignames et huile de palme. En 1482, Diego Cao arrive à l’embouchure du fleuve Congo et ainsi l’empire Congo entre en contact avec la civilisation européenne. Durant cette période, la traite des noirs menace l’empire avec les kidnappings des sujets du royaume par les marchants portugais. Cette pratique annonce le déclin de l’empire Congo. Avant que le déclin n’arrive, l’Empire Kongo donne naissance à l’un des rois les plus intelligents et le plus diplomatique de cette période, le Roi Alphonse I. Il est parmi les rares rois africains des années 1500 à savoir lire et écrire une langue européenne. En 1526, il envoya une lettre au Roi Joao III de Portugal en disant : « Chaque jour, les marchands kidnappent mon peuple- les enfants de mon pays, fils de nobles et vassal, et même les membres de notre famille… » C’est l’une de nombreuses lettres qu’il a écrit contre la traite des noirs et l’esclavage. Après sa mort, l’empire Kongo va en décadence. En 1665, les portugais soumettent les Bakongos à la bataille d’Ambuila. Beaucoup de noirs furent emportés au Brésil comme des esclaves. Leur port de déportation fut Emboma, l’actuel Boma. L’histoire de la république démocratique du Congo est une étude bien vaste qui couvre les différentes étapes de l’histoire. Il est bien normal que certains élèves imaginent que l’histoire du Congo commence avec la découverte de l’embouchure du fleuve Congo en 1482 suite à l’étude des grandes découvertes à l’école primaire. Toute fois, aujourd’hui nous allons couvrir la préhistoire du Congo.
Il est important de rappeler que la préhistoire est la période qui précède l’invention de l’écriture. Considérant cette période, les traces les plus anciennes de l’existence humaine sont associée aux préacheuléens découvert dans les sites archéologiques du Katanga et du Kivu, respectivement Katanda 2 et Sanga 5. Ces traces sont essentiellement des galets taillés dont l’âge est estimé à plus de 200,000 ans. Entre les traces de préacheuléen et des premiers villages, le Congo était habité par des peuples nomades, qui vivaient de la chasse et de la collecte. Ces peuples nomades sont peut-être les ancêtres des peuples pygmées, qui font la fierté de la république démocratique du Congo et dont la culture est encore méconnue. La découverte des nombreuses bifaces et hachereaux dans le site archéologique de La Kamoa au Katanga atteste l’existence de l’acheuléen. Le deuxième millénaire avant Jésus – Christ est une période des grandes migrations des peuples cultivateurs (Néolithiques). Un grand nombre d’entre eux sont des peuples bantous qui font leurs voyages à partir des années 3500 av. JC. Au Congo, les premières traces de la population pratiquant l’agriculture se matérialisent vers -2600 par la tradition « Imboga » dans le territoire de Mbandaka et du Lac Tumba, ensuite vers -2,300 par la tradition « Ngovo » au bas-congo et « Urewe » au Kivu (dans l’Est du pays.) Bien qu’il soit probable que les villages de l’Est du Congo utilisaient le fer avant ceux de l'Ouest, suite aux découvertes des fours de réductions dans les régions avoisinantes ; il est important de savoir que la métallurgie (utilisation du fer) par les autres communautés du Congo est plus évident à partir des années 2000 av. J.C. 1 définition
Le terme «préhistoire » a deux sens, il se définit à la fois comme science et comme période.
2 subdivision géologiques de la préhistoire La subdivision géologique de la préhistoire est une subdivision chronologique de l’histoire de la terre. Elle se caractérise par l’étude des différentes phases qu’a connues la terre pour que la vie y soit possible. Généralement on suppose que c’est au cours du précambrien que l’on assiste à la formation de la partie superficielle du globe terrestre et à l’apparition de la vie sur la terre. En effet, les géologues subdivisent l’histoire de la terre en 5 ères géologiques.
NB:
Durant le quaternaire, les climats de la terre subirent des variations considérables. Ces variations soumirent certains environnements à l’extension ou au retrait des couvertures glaciales et d’autres au développement de la vie. Au cours du quaternaire, le continent africain a connu certaines modifications physiques. Pendant cette période environs 6 millions d’années, le climat et les environnements de la terre subissent des variations considérables : « des vallées, des terrassas fluviales se formèrent, la faune et la flore subirent de modification importante ». Les différentes périodes d’humidités en Afrique ont des noms tirés des sites géographiques de l’Afrique orientale. Les noms ne sont plus utilisés aujourd’hui, les fluctuations de la pluviosité au cours de la Pléistocène permettant de diviser cette époque en succession des périodes qui sont respectivement: KAGUERIEN , KAMASIEN ,KANJERIE ,GAMBRIEN EUROPE NORD AMÉRIQUE DU NORD AFRIQUE GUNZ NEBRASKA KAGUERIEN MINDEL KANSAS KAMASIEN RISS ILLINOIS KANJERIEN 2.1 Définition
Les sciences auxiliaires de l’histoire sont celles dont l’histoire fait appel pour sa formation. Elle complète ou éclairent les recherches en histoire. 2.2 Typologie 1. La linguistique: Elle est l’étude scientifique des langues en particulier. elle étudie les phénomènes intéressant leurs évolutions, leurs développements, leurs répartitions dans le monde, leurs rapports et leurs structures. Elle permet de faire ressortir leur degré de parenté et de prouver qu’elles sont d’une origine commune. La linguistique est donc une science comparative des langues. 2. La philologie: C’est une discipline qui étudie la langue de document. Elle étudie l’évolution interne d’une langue. En effet, la connaissance approfondie d’une langue nous livre non-seulement le contenu d’un document, mais nous permet aussi de le restituer dans le temps et dans l’espace. 3. La paléographie: C’est l’étude des écritures anciennes c’est-à-dire la science qui enseigne à lire les documents; à déchiffrer les abréviations, en effet , à partir de l’écriture, on peut restituer un document dans le temps et éventuellement identifier son auteur. 4. La diplomatique: Science qui étudie les schémas et formules employés dans les actes publics pour en établir l’authenticité. Les documents relevant de la diplomatique sont notamment: les chartes, les diplômes, les actes officiels . . . La diplomatique a quelques auxiliaires : a)La chronologie :elle étudie les différents systèmes de datation, les ramènes au calendrier universel (ERE Chrétien).
b) La sigillographie : elle étudie les sceaux apposés sur les documents, qui furent longtemps les signes d’authentification par excellence . 5. L’onomastique: Elle étudie les noms propres, des lieux (toponymie), des personnes (anthroponymie), des eaux (hydronymie). 6. L’archéologie: Elle étudie les vestiges des civilisations anciennes enfouis dans le sol. Ces objets ou vestiges archéologiques doivent passer une technique de recherché . a) L’analyse pollinique : c’est l’étude des grains de pollen contenus dans les sédiments préhistoriques. Cette étude permet de reconstituer la flore. b) Le carbone 14 ou radio carbone: c’est une isotopie de carbone retrouvé dans les corps organiques (plantes, animaux). Le carbone 14 vient des échanges respiratoires avec l’atmosphère. Lorsque un corps organique cesse de vivre, le carbone 14 qu’il contient commence diminuer, à décroître, à se désintégrer à un taux régulier. 7. Numismatique Elle étudie les monnaies anciennes qui n’ont plus cours actuellement. Grace à elle, on peut connaitre la puissance d’un Etat et les pays avec lesquels il entretenait des relations commerciales. 8. L’héraldique : Étudie les armoiries (blasons) 9. La généalogie : Étudie les origines et la filiation des familles. 10. La géographie humaine : Etudie les origines et l’évolution d’une société en rapport avec le milieu physique où elle vit. Elle fait ressortir les influences réciproques entre l’homme et la nature. 11 L’épigraphie : Étudie les épigraphes (ou épitaphes) inscription sur une matière durable. 12 La cryptographie : Étudie les signes conventionnels, les écritures secrètes, les messages codés. Pour décrire l’histoire des homes, l’historien recherché , assemble, réuni toutes les sources ,tous les témoignages ,en bref tout ce qui subsiste des faits passés . Tel est l’objet de l’heuristique
1. Définition -on appelle sources ou documents , en histoire , tout ce à partir de quoi l’historien tente de reconstituer le passé humain . -c’est toutes traces, volontaires ou non, laissées par l’homme et qui explique sa présence . 2. Typologie (sortes) Les sources archéologiques Elle sont appelées sources muettes ou monumental : ce sont toutes les traces matérielles de l’homme , à l’exception des documents écrits . Ces sources sont plus sures , ce sont des témoignages irrécusables ou comme dirait un juge d’instruction <<des pièces à conviction >> pour deux raisons: - sa matière se prête moins au fraude ou à la falsification . – son caractéristique involontaire (contient des objets fait pour un but pratique). Dans les sources archéologiques l’on distingue les restes et les monuments : A. le reste -organiques : sont des restes corporelles d’hommes , d’animaux , des plantes , et d’aliment. –non organiques : tous les objets d’usage plus ou moins courant , tels que armes , casseroles , pots , cruches ,. . . Ces restes nous donnent des renseignements sur le genre de vie des peuples . B. les monuments Les monuments sont tous les objets fabriques par l’homme dans le but d’immortaliser quelqu‘un ou quelque chose, soit les restes qui ont servi d’habitation ou encore les objets destines à embellir la vie courante . ces monuments sont fait pour la postérité ,pour que les générations futures se souvienne d’un outil autre personnage . Ils sont faits pour durer. Exemple:
- Les sources archéologiques posent la difficulté d’interprétation car elle reste muette. Il est indispensable de disposer des textes pour les interprétés. - toute source muette n’est pas nécessairement une source archéologique. les sources archéologiques sont celles trouvés à partir des fouilles archéologique. 2.2 La tradition orale ou sources orales C’est un témoignage transmis oralement. mais toute source orale n’est pas nécessairement une traditions orale . la tradition orale se transmet oralement d’une génération à une autre . Exemples
La tradition orale présente 5 grands problèmes :
2.3 Les documents écrits La source écrite comprend tous les écrits de n’importe quelle manière , sur n’importe quelle matériel publié ou non . Dans l’ensemble de tout ce que l’homme a écrit , nous distinguons deux grands groupes :
Exemple:
- Documents prives : lettres de familles, correspondances commerciales. - Documents officiels : émanent de l’état ou des ses représentants : correspondances officielles ,décrets , textes législatives . . . -Documents juridico–religieux : livrets de baptême, de mariage . . . B.Les sources littéraires (narratives) sont les documents destines à informer les contemporaines ou la postérité . On peut les repartir en : 1.les œuvres historiques : qui consignent ou prétendent consigner les faits tells qu’ils se déroulent ou qu’ils se sont déroulés . Parmi elles , les annales d’abord , ou les événements sont disposés chronologiquement et avec le lieu . (les écrits des explorateurs et missionnaires ) puis les chroniques ,qui racontent le passé d’une nation ,d’une maison précieuse ,d’un monastère , Etc. … Enfin des œuvres comme les mémoires et thèses de doctorat. 2. les œuvres littéraires sans prétentions historiques, telles que les fables et les romans 3. les écrits d’informations immédiates : journaux hebdomadaires, revues ou les informations sont plus au moins exactes Les sources d’origines africaines a)les Hiéroglyphes en Egypte b) le Guèze en Ethiopie c) le Vai au Liberia et Sierra-leone d) le Bamoun au Cameroun e) le N’sibidi au Nigeria, d)Swahili à l’est de l’Afrique. 4. la source audio –visuelle ou document enregistré Cette catégorie de source présente l’histoire sur les disques , bandes magnétiques, la photographie, le cliché, le diapo, les films . Pour d’autres auteurs cette source fait partie de celle archéologique. Préparer par l'Equipe d'Exetat.net  http://pjpmartin.free.fr/ http://pjpmartin.free.fr/ Dans la préparation de la guerre sainte, Urbain II fut reconnu, au moins à un certain degré, comme le maitre des rois européens. Sous son leadership, des avantages extraordinaires furent offerts pour attirer des foules sous les drapeaux. Parmi ses avantages fut une indulgence plénière, remettant toutes les peines encourues pour leurs péchés, était acquise à ceux qui tomberaient au combat. Les serfs étaient libres de quitter la terre à laquelle ils étaient enchaînés ; les citoyens étaient exemptés des taxes ; les débiteurs profitaient d’un moratoire ; les prisonniers étaient élargis et les condamnations à mort étaient commuées, par une audacieuse extension de l’autorité pontificale, en un service militaire à vie en Palestine. Des milliers des vagabonds se joignirent à cette expédition sacrée. Des gens fatigués à porter une misère sans espoir, des aventuriers prêts à tout risquer, des cadets désireux de se tailler un fief dans les territoire d’Orient, des marchands à la recherche de nouveaux marches pour leurs produits et même des chevaliers que leurs serfs, en s’enrôlant, avaient laisses sans main-d’œuvre ; s’enrôlèrent sous le drapeau. Durant cette période, il courait des bruits fabuleux sur les richesses de l’orient et sur les beautés brunes, récompense offerte aux braves. Dans bien des cas, les femmes et les enfants insistèrent pour accompagner leur mari ou leur père, peut-être avec raison, car bientôt des prostituées s’enrôlèrent au service des hommes d’armes. Première phase. Vue la variété de motifs, il était difficile de rassembler une masse homogène capable d’une organisation militaire. Le Pape Urbain avait fixé les Mois d’Aout 1096 comme date de départ, mais les paysans impatients, qui avaient été les premières recrues, ne pouvaient attendre. Une première bande, au nombre d’environ douze mille personnes (parmi lesquels huit chevalier seulement) parti de France en mars sous la Conduite de Pierre l’Ermite et de Gautier Sans Avoir ; une autre d’environ cinq mille hommes, partit d’Allemagne sous la conduite d’un prêtre, Gottshalk ; une troisième arriva de Rhénanie sous la conduites du Compte Emico de Leiningen. Ce furent surtout ces bandes anarchiques qui s’attaquèrent aux juifs d’Allemagne et quand l’argent fut épuisé et qu’ils commencèrent à souffrir de la faim, ils furent forcés de piller des champs et les villages sur leur route ; et bientôt ils ajoutèrent le viol à la violence. Les populations résistèrent avec énergie ; les villes leurs fermèrent leurs portes et d’autres leur souhaitèrent bon voyage et bon vent. A la fin, ils arrivèrent devant Constantinople, sans le sou, décimés par la famine, la peste, la lèpre, les fièvres et les batailles au long de la route. Alexis leurs fourni des barques pour traverser le Bosphore, leur envoya des vivre et les pria d’attendre que les détachements mieux armées vinssent à leurs aide. Famine ou impatience, les croisés n’écoutèrent pas ces instructions et marchèrent sur Nicée. Un détachement des Turcs bien disciplinés, tous archers consommés, sortit de la place et anéantit à peu près complètement ce premier corps de la première croisade. Gautier Sans Avoir était parmi les morts ; Pierre l’Ermite, dégoûté de cette bande ingouvernable, s’en était retourner avant la bataille à Constantinople, et y vécut en sécurité jusqu’en 1115. |
Archives
Mai 2016
Catégories
Tous
|

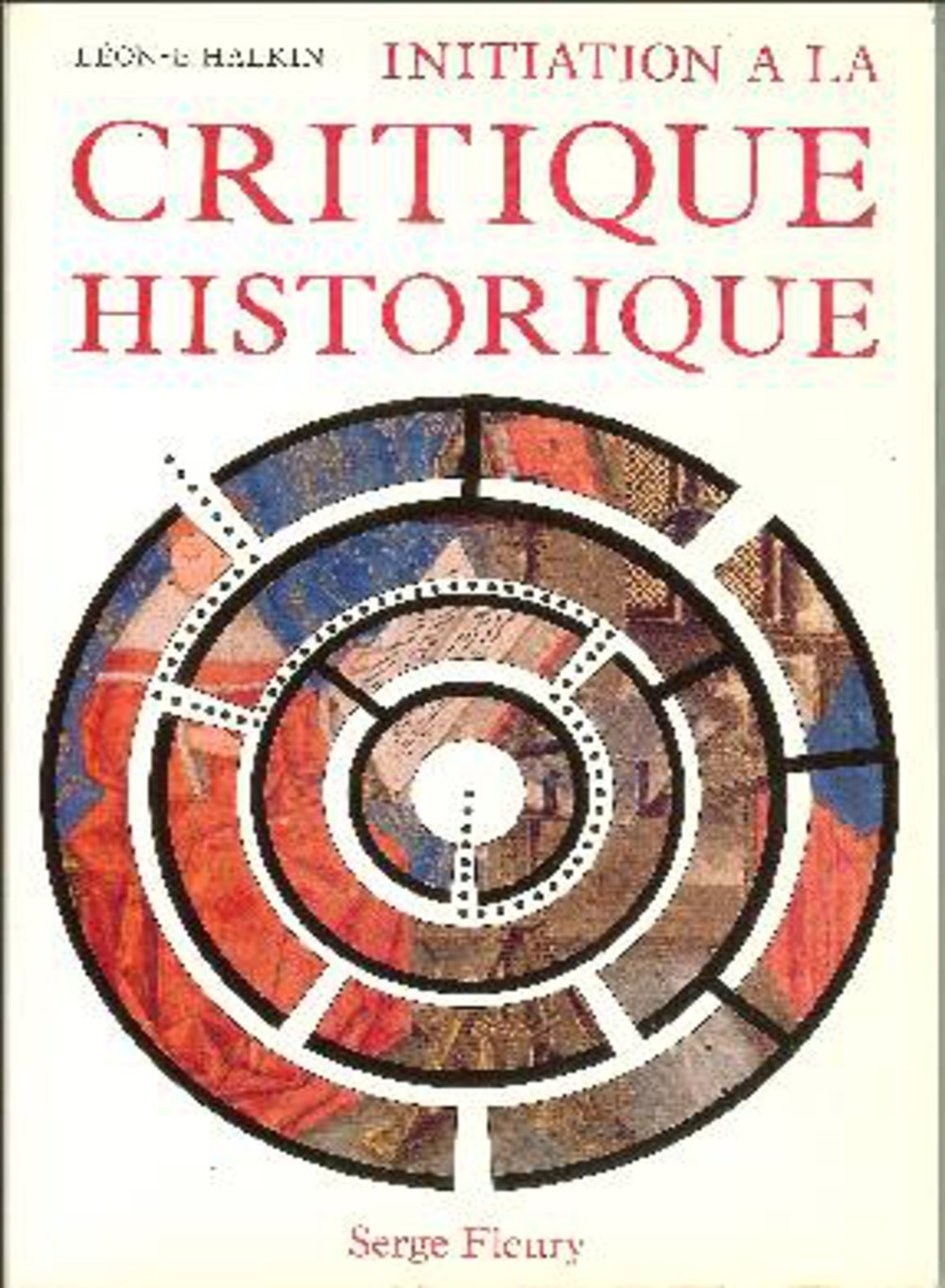
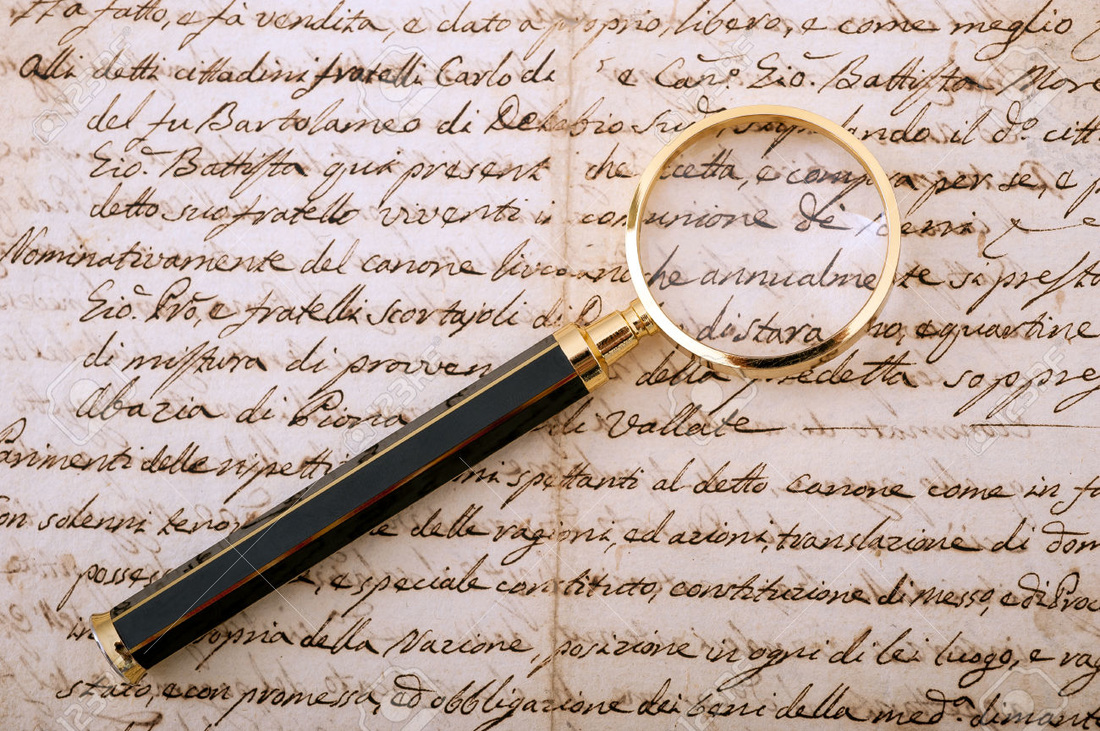







 Flux RSS
Flux RSS
